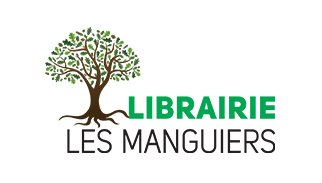Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fin mot du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
L'Europe face à la crise des migrants et des choixSamedi 12 Septembre 2015 - 13:30 C’est presque de la répétition, mais sans doute le meilleur moyen de faire entendre raison à ceux qui, délibérément ou non, refusent d’écouter le message : la crise des migrants à laquelle l’Europe fait face aujourd’hui est en partie la conséquence de la mauvaise thérapeutique appliquée par l’Occident aux conflits qui ravagent certains États africains et moyen-orientaux. Deux exemples, peut-être trois, révèlent en effet que si les puissances occidentales avaient agi autrement en Libye, en Syrie et en Irak, les rebondissements migratoires auxquels on assiste de nos jours n’auraient certainement pas eu la même ampleur. Premièrement la Libye : située dans une zone géographique traversée, en 2010, par le « printemps arabe » parti de chez son voisin tunisien, l’ancienne Jamahiriya arabe socialiste de Mouammar Kadhafi est entrée vite en ébullition. La nature du régime en place, institutionnellement peu structuré, l’absence de mécanismes facilitant le dialogue interne, et variablement le délitement de ce qui faisait office de force publique (rempart incontestable pour toute nation tombée dans une telle incertitude), ont exacerbé la fracture entre les forces en présence. D’un côté, un Mouammar Kadhafi décidé à « briser » l’insurrection par tous les moyens, de l’autre des contestataires intraitables. On se trouvait en face de deux camps résolus à en découdre. La France s’est engouffrée dans cette brèche très tôt, non sans susciter quelques réticences de la part de certains membres du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Au bout de plusieurs mois d’intenses bombardements, la massive intervention militaire de la coalition menée par Paris avait réussi à mettre le colonel Kadhafi dos au mur. Ce devait être assurément le moment d’arracher un accord historique entre ce dernier et les insurgés. Cela pouvait prendre du temps, mais aurait fini par donner à la Libye des institutions de transition à même de démocratiser ce pays fermé par le biais du vote populaire. Or, non seulement Kadhafi a été tué, mais en plus, le service après-vente n’a pas été assuré par ceux qui s’étaient employés, au long de cette guerre qui dura huit mois, d’aller au-delà de la stratégie recommandée par l’Onu qui consistait à affaiblir le régime libyen. Au bout de quoi, la Libye est aujourd’hui abandonnée à elle-même. D’importantes réserves d’armes du colonel Kadhafi ainsi que celles larguées par la coalition comme le confirment certaines sources, sont tombées entre des mains inavouées. Les milices font toujours la loi, la porte maritime libyenne donnant sur l’Europe est devenue un indispensable gagne-pain pour des passeurs impitoyables de migrants vers le Vieux continent. Le chaos s’est installé pour longtemps. Deuxièmement la Syrie : l’insurrection déclenchée le 15 mars 2011 avait été sévèrement matée par le régime de Damas aussitôt mis au ban de la communauté internationale. Pays fréquentable depuis toujours, puisque la plupart des capitales occidentales y étaient représentées au niveau des ambassadeurs, la Syrie a,, à son tour, basculé dans la violence. Que fait l’Occident ? Il opère un choix stratégique à la limite de la précipitation. Il choisit de soutenir des rebelles plus ou moins aseptisés dont il ne sait pas encore exactement quel but ils poursuivent et quelle est leur marge de manœuvre réelle. Aux avant-postes, Paris décide quelque temps après de la fermeture de la représentation diplomatique syrienne dans la Ville Lumière, puis ouvre dans la foulée les portes de l’Élysée aux chefs rebelles syriens considérés alors comme « les seuls représentants légitimes » du peuple syrien. C’était avant que ces derniers ne s’enlisent eux-mêmes dans des contradictions de personne, que les fondamentalistes gagnent du terrain et conquièrent, quatre ans jour pour jour après le déclenchement du conflit, leur propre territoire désigné pompeusement État islamique. Ils s’organisent depuis lors autour d’une importante portion de terre qu’ils ont « sculptée » entre l’Irak et la Syrie. Moyennant le massacre de civils, l’exacerbation des conflits confessionnels, la destruction de sites archéologiques classés au patrimoine de l’humanité, l’EI impose sa loi. Désormais, chaque groupuscule terroriste qui naît quelque part dans le monde lui fait allégeance. Au grand dam de l’Europe assiégée par les migrants. Enfin, en troisième lieu, l’Irak : une vieille histoire, puisque le premier conflit armé avec les États-Unis d’Amérique date de 1990. Saddam Hussein, ancien allié a trahi la cause de ses partenaires en occupant illégalement le Koweït. Une impétueuse « tempête du désert » menée par une coalition d’une trentaine de pays met fin à l’hégémonie bagdadienne et le raïs irakien sort de ce conflit affaibli. La seconde crise, moins justifiée, elle surfe sur de l’ivraie, les armes de destructions massives dont ne disposait pas le pays. Armes introuvables bien évidemment, mais la guerre achève de désarticuler complètement l’Irak dans ce qu’il pouvait avoir de confiance en soi. Le dictateur est pendu après un jugement que l’on disait parrainé par les occupants. Place à des institutions sorties des urnes, mais place à un enchaînement de violences jamais connues, entretenues ici également par des luttes confessionnelles. L’Irak, la Syrie, la Libye, ne sont plus ce qu’ils étaient. Par la faute de leurs dirigeants, cela va sans dire. Mais pas exclusivement. Par la faute aussi des ingérences extérieures robustes qui montrent, si on voit bien, la limite qui les accompagne lorsqu’elles ne sont pas suffisamment mûries. Il faut pourtant, dans le moment présent, louer la solidarité dont de nombreuses organisations caritatives, de nombreuses familles, de simples citoyens en Europe font preuve à l’égard de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants à la recherche du mieux-être loin de là où ils sont nés. Le premier miracle qu’ils opèrent est d’échapper à une mort certaine lorsqu’ils bravent les flots de la Méditerranée, le plus souvent à bord d’embarcation de fortune. Les moins chanceux, on le sait, périssent avant de voir la « terre promise ». Mais cette solidarité des peuples d’Europe à l’égard des migrants, pourrait-elle, à terme, instruire les gouvernements de leurs pays respectifs à mieux cerner les contours de leurs interventions militaires dans le monde, à accompagner les pays en crise dans le sens d’en préserver les équilibres fondamentaux ? C’est une question de choix, en principe de bons choix stratégiques. Un terrain sur lequel, très souvent, experts en ceci ou cela, les plus aguerris dans ce domaine y perdent leur latin. Pour preuve, la question que l’on se pose aujourd’hui au regard de l’ampleur de la crise des migrants est la suivante : comment venir à bout de l’État islamique ? Gankama N'Siah Edition:Édition Quotidienne (DB) Notification:Non |