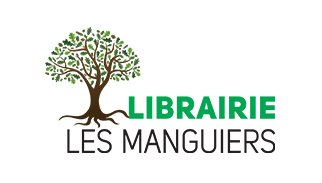Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fin mot du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
Simon KimbanguVendredi 3 Avril 2015 - 16:50 C’est le 6 avril que Simon Kimbangu crée l’église de Jésus-Christ sur la terre que l’on nomme aussi kimbanguisme, dans l’actuelle R.D. Congo. C’est un mouvement prophétique qui s’ordonne autour de son fondateur, porteur de messages célestes. Qui est Simon Kimbangu ? La légende et les faits historiques s’imbriquent à ce sujet. Simon Kimbangu naît à Kamba, en 1881, d’après Van Wing, le 24 septembre 1889 d’après Georges Balandier. Nkamba est alors évangélisé par la Société des missionnaires baptistes qui vont avoir une influence sur Kimbangu. Lorsque sa mère décède, il est élevé par sa tante, guérisseuse de son état. C’est à la suite de visions et de rêves répétés que Kimbangu découvre sa vocation de serviteur de Dieu. Il est marié et père de plusieurs enfants. Nkamba, où il a eu ses visions, devient la nouvelle Jérusalem. Il décide de prêcher la nouvelle foi à son peuple et commence ses miracles. Un jour, il trouve sa tante malade. Il la bénit au nom du Seigneur. La malade se lève et va se baigner dans la rivière Nkamba. Elle sort de ce bain guérie. Cette guérison est attribuée à la bénédiction de Kimbangu. Mayi ya Nkamba, le nom congolais de la rivière Nkamba, a, dès lors, la réputation d’être un cours d’eau sacré. Après ce premier miracle, il ressuscite un enfant du village de Kukengo. Il parcourt la région, suivi d’un groupe de cinq disciples : Thérèse Mbongo, Mikara Mandombé, John Makoba, Pierre Nangi et Papa Tshiampa, enseignant sa nouvelle religion et accomplissant des guérisons miraculeuses. Son enseignement compte trois lois d’ordre moral. La première impose la destruction de tous les fétiches ; la seconde interdit les danses licencieuses ; la troisième condamne la polygamie. Pour les fidèles de Kimbangu, Nkamba devient un lieu de pèlerinage. Ce qui provoque l’inquiétude de l’administration coloniale qui essaie d’enrayer les migrations vers ce lieu de culte. Elle interdit notamment, pour des raisons d’hygiène publique, le transport des malades. Sur ordre de ses supérieurs, le 11 mai 1921, Morel, alors administrateur du territoire de Thysville, se rend à Nkamba pour enquêter sur place. Malgré ses tentatives, il ne parvient pas à établir un contact avec Kimbangu. Ce désagrément contribue à élargir le fossé entre ce dernier et l’administration. Au début du mois de juin, l’arrestation de Kimbangu est ordonnée. C’est Morel qui s’en charge. Accompagné de vingt soldats, il trouve le prophète qui réussit à s’échapper au cours de la lutte qui s’est engagée entre lui et les soldats. Sa fuite, considérée comme miraculeuse, accroit davantage sa renommée dans la contrée. Dès lors, commence pour Kimbangu, une période de clandestinité. Il vit à Nsanda, un village près de Kinshasa. C’est au cours de cette période que le mouvement manifestera des tendances millénaristes. Les adeptes attendent la seconde venue du Christ. Le 14 septembre 1921, Simon Kimbangu est arrêté avec plusieurs disciples à Nkamba où il s’est rendu volontairement. Son procès se déroule devant le conseil de guerre de Thysville. Il comprend un juge unique, le commandant de Rossi. Le prophète est condamné à mort. Malgré une violente campagne de presse déclenchée par le journal « L’avenir colonial belge », il est gracié par le roi Albert de Belgique. Transféré à la prison de Lubumbashi, Kimbangu meurt en 1951, après 30 années d’emprisonnement. Du côté du Moyen-Congo, actuelle République du Congo, Samuel Matouba et David Mfouka reçoivent le message de Simon Kimbangu et le propage dans les localités de Boko. Au nord, Antoine Fadoma fonde le village de Kounzoulou au bord du fleuve Congo, en aval de Liranga. Dans cette localité, il réussit à convertir Paul Obambi au Kimbanguisme. Il en devient le chef. Ces deux communautés s’ignoraient. Le 26 mai 1961, l’État congolais indépendant, par son ministère de l’Intérieur signe la reconnaissance officielle de l’église kimbanguiste sous le n° 662/INT/AG. Le 3 septembre 1962, le chef spirituel de l’église kimbanguiste, Dialungana Kuntima et son adjoint Dialungana Kiangani mettent en place les instances dirigeantes de l’église kimbanguiste au Congo. Le révérend pasteur Samuel Matouba assume les fonctions de représentant légal, dirigeant le collège national du Congo jusqu’à sa mort, jour pour jour, le 3 septembre 1970. Depuis, d’autres ont pris sa relève et l’église kimbanguiste continue son expansion. Elle dispose, sur toute l’étendue de la République du Congo, d’environ dix temples et de près d’une centaine de chapelles et de « fokola », genre de grands hangars, pouvant contenir entre 3000 et 5000 personnes. Près d’une centaine de pasteurs officient dans ces différents lieux de culte. Ces chiffres sont en perpétuelle augmentation. Mfumu Edition:Édition Quotidienne (DB) |