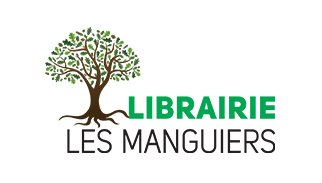Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fait du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
Poto-Poto et l’éducationJeudi 5 Novembre 2015 - 13:30 Brazzaville et Bacongo constituent, ce que Balandier appelait, «Les Brazzaville noires». Au moment où l’on parle des phénomènes de déviation sociale (crapulerie, agressions, vols et viols) dans nos cités, le thème de l’éducation me revient à l’esprit. Certes, Poto-Poto a eu ses déscolarisés célèbres, qui ont parfois basculé dans le banditisme comme Loubaki Ferrat, Gambali, les jeunes de Poto-Poto ont privilégié l’école comme garde-fou aux dérives. Poto-Poto avait deux types d'écoles : laïques d'une part (la Grande école de Poto-Poto et l'école de la Mosquée, actuellement Marcel Bissila) et l'école Ménagère, d'autre part, religieuses (Saint-Vincent A et B, et Sainte –Thérèse). Les élèves de ces écoles étaient astreints à assister au catéchisme et à la messe du dimanche. Les cours commençaient systématiquement par la prière. Toutes les écoles confessionnelles tomberont dans le giron de l'école laïque, en 1965. Avec la nationalisation de l'enseignement, l'école Sainte-Thérèse devient d'un côté de l'enceinte collège du 8 février et de l'autre, le collège technique Tchimpa Vita. Pierre Nzoko et 15 août 1963 remplacèrent la dénomination Saint-Vincent. Les anciens noms ont résisté à l'oubli et ont continué d'être utilisés de façon informelle. Avant l'ouverture des collèges, dans le quartier, tous les élèves allaient dans les différents collèges : Mafoua Virgile, Ganga Edouard et dans les lycées de la ville : Chaminade, Savorgnan de Brazza, Technique (1er Mai). On note, à Poto-Poto, avant les indépendances, l'existence d'une école maternelle, avec une prédominance d'écoliers Européens. L'éducation, c'était aussi le débat multidimensionnel: sur la musique, le sport, la culture générale et la politique. Le marxisme-léninisme et, surtout, le maoïsme furent au centre des discussions enflammées. L'éducation, ce n'est pas que l'école, c'est aussi la famille et le quartier. Dans les familles, jusqu'à une période pas lointaine, l'éducation dans les familles était rigoriste. Le respect des valeurs, dont les dix commandements sont le condensé, était le fondement de l'éducation. Les pères de famille, même de condition sociale modeste, jouaient pleinement leur rôle de chef de famille. Le quartier était une famille élargie où, dans toutes les parcelles, on était accueilli en enfant de la famille et soumis aux mêmes obligations de respect des valeurs. Au moment du repas, même venu à l'improviste, on avait droit à son écuelle. Ce sont ces valeurs, au centre desquelles, le respect, qui structurent l'enfant de Poto-Poto. Un papa du quartier est le papa de tout le monde. Un grand-frère du quartier est le grand-frère de tous. La solidarité y était la règle cardinale. Mais, devant un excès d'autorité, l'enfant de Poto-Poto peut être frondeur, rebelle, voire canaille. À l'époque de mon enfance, la rue était l'espace de jeu par excellence. Un lieu d'éducation multiforme. Les filles y jouaient au kebo, ndzango et autres occupations ludiques ; les garçons s'y adonnaient au football. Nos plus grands footballeurs sont sortis de ces terrains de fortune. Parfois les cours d'écoles servaient de stade. Les feux de camp étaient les rares occasions, au cours desquels les parents permettaient à leurs enfants de rester tard, hors de la maison. La Grande école de Poto-Poto était réputée pour ses feux de camps. Bref, sans tomber dans une nostalgie larmoyante, on peut dire qu'il faisait bon vivre à Poto-Poto. MFUMU Edition:Édition Quotidienne (DB) Notification:Non |