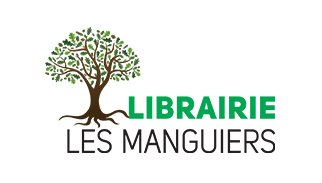Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fait du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
Regard sur les cinquante dernières années(1965-2015) (2) 1966Jeudi 21 Janvier 2016 - 17:15 Une naissance, comme il y en a tous les jours dans notre pays, est un événement privé. C’est la conjonction favorable ou défavorable d’un certain nombre d’éléments qui en fait, parfois, des années après, un moment historique de la vie d’un pays. C’est le cas de l’arrivée sur cette terre des hommes, le 24 février 1966, à Mouyondzi, d’Alain Mabanckou. Le prix Renaudot, fondé en 1925 et décerné chaque année en même temps que le prix Goncourt, a fait entrer Alain Mabanckou, dans le panthéon de la littérature française et africaine. Il l’a obtenu le 6 novembre 2006 pour son roman Mémoire de porc-épic. Un an auparavant, il avait remporté le prix des cinq continents de la Francophonie, avec son précédent ouvrage Verre cassé. Auteur de plusieurs livres à succès, Alain Mabanckou enseigne la littérature africaine à Los Angeles aux Etats-Unis. Dix ans, après le Renaudot, consécration pour cet écrivain franco-congolais. Il est nommé, dimanche 29 novembre 2015, professeur à la chaire annuelle de création artistique du Collège de France. Il y prononcera sa leçon inaugurale le 17 mars prochain. Au programme, la littérature africaine. Alain Mabanckou est le premier écrivain appelé à occuper cette chaire, créée en 2004. Il succède à des créateurs tels que l’architecte Christian de Portzamparc, le compositeur Pascal Dusapin, le sculpteur Anselme Kiefer ou le paysagiste Gilles Clément. Il faut rappeler que le Collège de France a été créé en 1530 par François 1er, avec une double vocation : être à la fois le lieu de la recherche la plus audacieuse et celui de son enseignement. C’est donc une consécration dont devrait se réjouir tout le peuple congolais, quelque soit l’opinion, bonne ou mauvaise, que l’on peut avoir de l’écrivain. Au mois de mai 1966, Ambroise Noumazalaye est nommé Premier ministre par le président Alphonse Massamba-Débat, en remplacement de Pascal Lissouba. Jusqu’à son décès à Paris, le 17 novembre 2007, il était président du Sénat et secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT). Né le 23 septembre 1933 à Bétou, dans le département de la Likouala, Ambroise Noumazalaye s’intéresse très tôt à la politique, au Congo puis en France, où il milite au sein de la Feanf (Fédération des étudiants d’Afrique noire en France). À son retour au pays, il devient, en 1964, secrétaire général du Mouvement national de la Révolution (Mnr). Il est l’un des fondateurs du PCT. Malgré l’indépendance en 1960 et la Révolution des 13, 14 et 15 août 1963, les forces françaises disposent toujours d’une base militaire au Congo. Ce n’est qu’en 1965, qu’elles quitteront Brazzaville et le reste du pays. Le 22 juin 1966, la loi n°011-66, du 22 juin 1966, est promulguée. Elle crée l’Armée populaire nationale (Apn), anciennement Forces armées congolaises (Fac), dénomination réappropriée depuis quelques années. En juin 2016, l’Armée congolaise fêtera le cinquantenaire de sa naissance. Pour mémoire, la première unité congolaise est créée le 16 novembre 1960. Le 27 juin 1966, un mouvement de protestation contre la décision, deux jours plus tôt, de faire du capitaine Marien Ngouabi un simple soldat de 2ème classe. La Primature, que vient d’occuper Ambroise Noumazalaye, et le siège du Mnr sont attaqués par une foule en furie. L’intervention musclée des éléments de la Défense civile (milice du pouvoir) réussit à disperser les manifestants. Poto-Poto, où résidait la plupart d’entre eux, est soumis à une véritable chasse aux sorcières. De nombreuses arrestations sont opérées. C’est le début d’une série de turbulences politiques qui conduiront, deux années plus tard, Marien Ngouabi, au sommet de l’Etat. A l’origine de cette fulgurante ascension, sa rétrogradation qui l’a mis sous les feux de la rampe. Nous en reparlerons dans le papier qui sera consacré à l’année 1968. Au début du mois d’août 1966, au cours d’une tournée ouest-africaine, Jean Serge Essous, cofondateur et chef de l’orchestre Bantous, abandonne ses collègues à l’étape d’Abidjan. Il se rend en France. Suite à cette désertion, Nino Malapet devient le chef de l’orchestre Bantous. Il est adoubé par les deux derniers cofondateurs, encore en place, Edo Ganga et Celio Kouka.
MFUMU Edition:Édition Quotidienne (DB) Notification:Non |