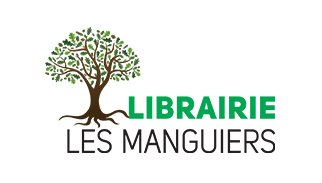Opinion
- Éditorial - Les Dépêches de Brazzaville
- Réflexion - Jean-Paul Pigasse
- Le fin mot du jour - Gankama N'Siah
- Humeur - Faustin Akono
- Chronique - Boris Kharl Ebaka
- Brin d’histoire - Mfumu
- Tribune libre - Sergueï Lavrov
- Idées-forces - Les Dépêches de Brazzaville
- Analyse - Xinhua
Tribune libre : Leviers et freins de la création d’entreprises au CongoMardi 2 Juin 2015 - 15:18 L’évolution des créations d’entreprises dans les activités économiques délaissées depuis longtemps au Congo, au profit des activités rentières (pétrole, bois), est un indicateur pertinent de la mesure du dynamisme de l’entrepreneuriat dans le cadre de la diversification de l’économie et de l’assainissement du climat des affaires pour sortir le pays du syndrome hollandais («Les Dépêches de Brazzaville» n°2127 du 2/10/2014 p.4). Cette politique qui s’appuie sur la loi 019/86 du 31 juillet 1986 portant la promotion des PME/PMI se base sur plusieurs structures d’appui à l’entrepreneuriat comme l’Agence de développement de la PME (ADPME, 1986), le Fonds de garantie et de soutien aux PME (1987), le Fonds d’intervention et de promotion de l’artisanat et l’Agence nationale de l’artisanat (ANAR, 1986), l’Agence pour la promotion de l’investissement et la Maison de l’entreprise (2008). Ces structures se superposent, sans offrir un service de qualité aux investisseurs. La Maison de l’Entreprise qui héberge le Centre de formalités administratives des entreprises (CFE), créé en 1994 dont l’objectif principal est de faciliter la création d’entreprises en réunissant en un Guichet Unique, en un seul document, en un seul paiement, et en moins d’une heure, toutes les formalités liées à la création, au transfert, à l’extension, à la modification et à la cessation d’activités, est loin de produire les effets structurants escomptés sur l’entrepreneuriat. Des chiffres qui renseignent Certes, le rapport de la Banque africaine de développement de 2012, sur l’investissement privé au Congo, souligne le dynamisme de l’économie nationale par les créations d’entreprises qui ont plus que doublé en cinq ans, en passant de 2.286 en 2005 à 6.093 en 2010. Dans ces créations, 87,64% sont des Entreprises individuelles (EI), 11,22% des Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL), 0,97% des Sociétés Anonymes (SA) et 0,17% d’autres formes. Ce sont des micros entreprises ayant à 97,84% un capital de moins de 5 millions de FCFA. 98 % d’entre elles ont moins de cinq salariés. Elles génèrent 3,250 millions de $US de chiffre d’affaires avec une croissance de 91,96% sur ces trois dernières années, et se concentrent à Brazzaville (55 %) et à Pointe-Noire (40 %). Les frais de création d’une IE s’élèvent à 75000 F CFA, contre 145 000 FCFA pour une SARL et 195 000 pour une SA. Le créateur est à 70,55% un homme et à 29,45% une femme. Il est âgé à 77,50% entre 26 et 55 ans. Sa formation de base est universitaire à plus de 60%. Sa nationalité est congolaise à 88% et à 12% étrangère dont 6% d’Ouest-Africains, 2% d’Américains, 1,7% d’Asiatiques et 2,3% d’autres nationalités. Les secteurs les plus créateurs d’entreprises sont ceux qui contribuent le moins à la production de la richesse nationale. On Compte 66% de créations dans le Commerce et 18% dans les Services, contre 9% dans les Mines et le Pétrole et 1% seulement dans l’Industrie. Or, les Mines et le Pétrole produisent plus de 70% de la richesse nationale, le Commerce et les Services 19,8%, l’industrie 3,4%, l’Agriculture 3,3%, la Construction 2,9% et l’Énergie 0,6%. Cela signifie que 84% des créations d’entreprises sont réalisées dans le Commerce et les Services, secteurs qui ne produisent que 19,80% de la richesse nationale; alors que 26% seulement des créations sont faites par les secteurs produisant 80,20% de la richesse nationale. Les créations d’entreprises au Congo suivent donc la loi de Pareto de 80/20, selon laquelle, 80% des effets d’un phénomène sont le produit de 20% seulement des causes. D’autres aspects à prendre en compte En développant ces 20% des causes, on amplifie fortement le phénomène. Or, au Congo, les mesures d’amplification des créations d’entreprises sont limitées par : - la nature non innovante et non pérenne du projet d’entreprise : la création d’entreprises est soit le produit des stratégies de captation de facilités et d’avantages accordés par l’État dans le cadre de ses programmes d’investissement (municipalisation accélérée), soit réalisée pour tirer profit des réformes institutionnelles de l’État (privatisation des entreprises d’État), soit résulte du bénéfice d’un marché public éphémère par une personne qui s’improvise entrepreneur, alors que son entreprise disparaît même avant l’exécution du contrat ; - le faible soutien bancaire dans le financement de l’investissement et l’exploitation : sur les 150 entreprises interrogées en 2009 par la Banque mondiale, 84,2 % utilisent leurs fonds propres pour financer leurs projets contre 3,4% qui bénéficient des emprunts bancaires. Seulement 11,6% d’entreprises disposent d’une ligne de crédit auprès des banques contre 29,5 % au Burkina Faso et 42,11 % au Cameroun ; - le poids de la bureaucratie et la pression fiscale : sur l’échelle du Doing bisness de la Banque mondiale qui note le climat des affaires dans 185 pays du monde, le Congo a perdu 32 places en 10 ans, en passant du 146e rang mondial en 2005 au 178e rang en 2015. La pression fiscale des entreprises a augmenté de 173%, en passant de 167,80 milliards de FCFA d’impôts et taxes payées en 2005 à 291,24 milliards de FCFA en 2009. Plus de 61 procédures fiscales mobilisent 25 jours, plaçant le pays au 182e rang mondial. La création d’une entreprise nécessite 11 procédures et 161 jours, situant le Congo au 180e rang mondial. Une opération d’importation de marchandises nécessite 14 procédures, représentants 62 jours (181e rang), une expédition de marchandises nécessite 11 procédures mobilisant 50 jours (181e rang), et 44 procédures permettent l’exécution d’un contrat, nécessitant 560 jours (162e rang). Les administrations partenaires du CFE n’étant pas toutes représentées dans ses locaux, le parcours du créateur d’entreprise demeure quasiment le même qu’avant 1994. Ainsi, le développement du potentiel entrepreneurial du Congo est-il entravé par le poids de la bureaucratie, la forte pression fiscale et la faible incitation de l’entrepreneur innovant. Une meilleure simplification administrative et une coordination efficiente des structures incitatives sont nécessaires pour promouvoir et développer un entrepreneuriat innovant, dynamique et responsable.
Par Emmanuel Okamba, Maître de Conférences HDR en Sciences de Edition:Édition Quotidienne (DB) Notification:Non |